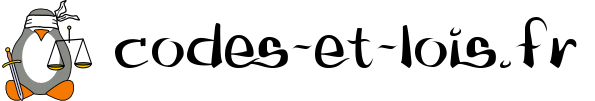Refonder les relations entre auteurs et bibliothèques sur les droits culturels
– S.I.Lex – - calimaq, 21/01/2018
Lire la suite de Refonder les relations entre auteurs et bibliothèques sur les droits culturels
Cette semaine aura donc vu la conclusion de la polémique qui durait depuis de longs mois autour de la taxation des lectures publiques gratuites. Affrontant depuis plusieurs semaines un tollé généralisé, la SCELF (Société Civile des Editeurs de Langue Française) a finalement annoncé dans un communiqué paru jeudi dernier qu’elle accordait une exonération valable 5 ans pour les lectures publiques non-marchandes, qu’elles soient effectuées en bibliothèque ou par l’auteur lisant son propre texte. Le Ministère de la Culture a salué cette décision comme une «avancée sur les droits de représentation», dans la lignée des déclarations de Françoise Nyssen selon laquelle la redevance de la SCELF constituait une « absurdité symbolique ». De leur côté les auteurs, notamment à travers la Charte des Auteurs et Illustrateurs Jeunesse, ont également salué cette décision en rappelant que s’ils étaient attachés au droit d’auteur, ils ne voulaient pas que celui-ci soit exercé de manière « maximaliste » par les éditeurs contre leur volonté. Enfin, l’ABF (Association des Bibliothécaires de France) a déclaré que cette solution relevait à ses yeux «d’un juste équilibre entre le droit d’auteur et les droits culturels».

Il reste à présent pour ces acteurs à conclure dans les jours qui viennent un accord formalisant cette exemption, avec quelques points de vigilance encore à régler, comme la (légitime) revendication des auteurs d’être également exonérés lorsqu’ils effectuent des lectures publiques en étant rémunérés ou le fait de savoir si l’exemption s’étendra aussi aux associations de bénévoles. Mais globalement, ce conflit aura débouché sur un résultat qui satisfait les revendications des représentants des auteurs et des bibliothèques opposés à la SCELF. Cette « alliance » constitue d’ailleurs en elle-même un élément remarquable, qui a joué un grand rôle dans cette affaire. Depuis 10 ans que je m’intéresse et que j’agis pour défendre les usages collectifs en bibliothèque, je n’avais jamais eu l’occasion de voir une telle alliance se nouer entre auteurs et bibliothèques. Il faut remonter au grand débat sur le droit de prêt en bibliothèque au début des années 2000 pour trouver l’exemple d’une telle convergence, attendu que le consensus parmi les auteurs était moindre à l’époque que celui qui s’est établi sur cette question de la gratuité des lectures publiques.
Or il me semble que la constitution de ce front commun a un sens particulier sur lequel il convient de s’arrêter. J’ai pu voir certains de mes collègues bibliothécaires rester dubitatifs ou déçus par rapport au fait que la SCELF n’ait accordé qu’une exemption pour 5 ans et qui auraient préféré que l’affaire se termine par l’adoption d’une exception au droit d’auteur en bonne et due forme. A mon avis, c’est une erreur d’analyse, car cette exemption constitue au contraire une manière efficace et immédiate de garantir les droits collectifs liés aux lectures publiques, bien davantage sans doute que ne l’aurait permis une exception. Par ailleurs, ce mécanisme inédit ouvre peut-être des perspectives intéressantes pour refonder de manière plus large les relations entre auteurs et bibliothécaires autour de la question des droits culturels.
Comme le dit l’ABF dans son communiqué, cette exemption traduit un « juste équilibre entre le droit d’auteur et les droits culturels » et il me semble qu’il faut s’efforcer de tirer toutes les conséquences du changement de paradigme qui s’est fait jour dans cette affaire, en regardant les perspectives qui se dessinent peut-être au-delà.
Un large consensus autour des droits culturels liés aux lectures publiques
L’élément qui a « cimenté » l’alliance entre les auteurs et les bibliothécaires, c’est la conscience partagée de l’importance des usages culturels en jeu au travers des lectures publiques gratuites. A contrario, les prétentions de la SCELF cherchant à les soumettre à une autorisation préalable et à une redevance ont paru violemment illégitimes, quand bien même cette société d’éditeurs pouvait se prévaloir d’avoir la légalité de son côté. C’est ce que traduit la pétition « Shérézade en colère » initiée par un collectif d’auteurs et de bibliothécaires, qui a recueilli plus de 30 000 signatures.
En octobre 2016, lorsque j’ai publié mon premier billet pour réagir aux prétentions de la SCELF et inciter mes collègues bibliothécaires à résister, il m’a paru essentiel de positionner le débat sur le terrain du respect des droits culturels. Or c’est bien cet angle de contre-attaque que l’ABF a adopté ensuite pour justifier son refus de se plier à ces exigences :
les lectures publiques et les heures du conte relèvent de plusieurs droits culturels reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’homme tel que le droit de participer librement à la vie culturelle.
Cette référence aux droits culturels est importante, car ceux-ci ont été reconnus par la loi NOTRe du 7 août 2015, ainsi que par la loi Création du 7 juillet 2016. Ils trouvent leur source au niveau international dans la Convention de l’Unesco de 2005 sur la la diversité des expressions culturelles, ainsi que dans des instruments comme la Déclaration de Fribourg de 2007.
Si les bibliothécaires ont rapidement invoqué explicitement les droits culturels, ce sont pourtant les représentants des auteurs qui en ont le mieux traduit l’esprit dans les protestations adressées à la SCELF. En effet, les différentes organisations d’auteurs (SGDL, Charte, CPE, etc.) qui sont montées au créneau pour défendre les lectures publiques gratuites ont été très claires depuis le début sur le fait qu’elles ne demandaient pas à ce que le droit d’auteur soit mis à l’écart. Mais elles exigeaient néanmoins qu’il ne soit pas appliqué pour faire obstacle à l’exercice de pratiques culturelles qu’elles jugeaient essentielles. Il ne s’agissait pas de nier l’existence du droit d’auteur et de sa légitimité, mais de le concilier avec d’autres droits fondamentaux, comme le droit de participer à la vie culturelle dont la liberté des lectures en public est la condition.
Or l’essence même des droits culturels – et ce qui fait toute leur force symbolique – consiste à affirmer le caractère indissociable des droits fondamentaux et le fait que nul ne peut utiliser un droit culturel pour empêcher autrui d’exercer le sien. Ce qui est apparu ici, c’est que les lectures publiques ne constituaient pas un droit des auteurs, ni un droit des bibliothèques, mais un droit indissociable appartenant de manière solidaire à l’ensemble de ces acteurs, au nom de valeurs partagées à défendre ensemble. Pouvoir lire des livres à des enfants sans autorisation à demander, ni redevance à verser ; pouvoir faire découvrir des auteurs en lisant leurs textes et éveiller le goût de la lecture ; pouvoir faire rayonner la diversité culturelle à travers la lecture à haute voix : voilà les principes fondamentaux qui étaient en jeu dans cette affaire et c’est sur la base de cette conscience partagée que l’alliance entre auteurs et bibliothécaires a pu se nouer.
De son côté, la position de la SCELF était à l’opposé de cette lecture en terme de droits fondamentaux. Son raisonnement consistait à dire que puisque les lectures en public relève du droit de représentation inclus dans le droit d’auteur, alors celui-ci devait mécaniquement être appliqué. Dans cette vision, tous les usages d’une oeuvre sont considérés comme des préjudices infligés à l’auteur et aux ayants droit, ce qui justifie qu’ils fassent l’objet d’une autorisation préalable et d’une redevance à titre de compensation. Mais s’agissant des lectures publiques gratuites en bibliothèque, ou même des lectures payantes effectuées par l’auteur lisant son propre texte, on voit bien que l’interprétation en termes de préjudice subi ne peut être retenue sans sombrer dans l’abus de droits.
C’est donc à mon sens une prise de conscience collective de l’importance de défendre les droits culturels qui a animé la mobilisation de ces dernières semaines et qui lui a donné la force de faire plier la SCELF en lui arrachant une exemption des usages pour les 5 années à venir.
L’exemption, mieux qu’une exception ?
On pourrait néanmoins considérer que si les lectures publiques gratuites sont légitimes et nécessaires à l’exercice de droits fondamentaux, elle devraient logiquement faire l’objet d’une exception législative au droit d’auteur, comme c’est le cas par exemple depuis 2006 en France pour les usages pédagogiques d’oeuvres protégées. J’ai pour ma part souvent défendu l’élargissement des exceptions au droit d’auteur et je persiste à penser que c’est une solution qui devrait davantage être mobilisée. Mais en ce qui concerne les lectures publiques, je pense au contraire que l’exemption obtenue par la coalition des auteurs et des bibliothécaires constitue la meilleure solution et je ne militerai pas pour que le législateur intervienne à présent pour transformer cette exemption en une exception. Des raisons de plusieurs ordres me conduisent à cette conclusion.
La première est pragmatique : l’exemption ici accordée va permettre immédiatement à la tolérance qui avait prévalu jusque ici d’être reconduite, ce qui signifie que les usages vont bien rester libres et gratuits. La SCELF exigeait notamment que les bibliothèques lui adressent une demande d’autorisation minimum trois mois à l’avance pour pouvoir lire un livre à leur public, même dans le cadre d’une Heure du Conte ! Ce genre de délires n’est plus à craindre, de même que les 100 euros de paiement forfaitaire à l’année que la SCELF avait un moment proposé comme solution de repli. Liberté et gratuité complètes : c’est le bénéfice immédiat que permet d’atteindre l’exemption et il me semble qu’il faut s’en réjouir.
Pourrait-on obtenir un résultat identique par le biais d’une exception ? Rien n’est moins certain. On peut par exemple faire la comparaison avec l’exception pédagogique et de recherche, qui a été introduite en 2006 par la loi DADVSI. Les usages en question ne sont pas moins légitimes que les lectures publiques. Pourtant, l’exception pédagogique a été formulée d’une manière extrêmement complexe, qui la rend difficilement applicable en pratique, avec de nombreuses insuffisances et limitations. Par ailleurs, elle n’est pas gratuite et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de l’Education Nationale doit verser plus de 2 millions d’euros par an à des sociétés de gestion collective en compensation du « préjudice » subi. Ce résultat bancal n’est pas un accident, mais le produit de « l’infériorisation structurelle » qui frappe les exceptions au droit d’auteur. En France, on considère qu’elles ne sont justement que des exceptions et pas de véritables droits, ce qui explique les « mutilations législatives » dont elles font l’objet. La plupart des nouvelles exceptions introduites depuis le début des années 2000 (exception conservation, exception pour la numérisation des oeuvres orphelines, liberté de panorama, Text et Data Mining) ont été affectées par ce problème, si bien qu’il n’en résulte souvent que des « trompe-l’oeil » législatifs, sans réelle portée sur les usages.
Par ailleurs, quand bien même le législateur français voudrait introduire une exception en faveur des lectures publiques que, sans doute, il ne le pourrait pas, car sa marge de manœuvre en la matière est limitée par la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur. Ce texte contient en effet une liste limitative d’exceptions que les Etats membres peuvent choisir de transposer, mais ils ne sont normalement pas autorisés à aller au-delà. La directive de 2001 est actuellement en cours de révision devant le Parlement européen, dans un contexte houleux (en partie d’ailleurs parce que des exceptions sont en discussion…). Mais pour l’instant, aucune proposition n’a été faite pour créer une nouvelle exception en faveur des lectures publiques. Il en résulte que la France n’aurait pas eu le droit de légiférer sur le sujet et qu’elle ne l’aura sans doute toujours pas à l’avenir…
L’exemption accordée par la SCELF était donc en réalité la seule manière d’avancer pragmatiquement sur les lectures publiques et il me semble en outre que politiquement, c’était la meilleure voie à emprunter. Si les bibliothécaires avaient en effet revendiqué le bénéfice d’une exception plutôt que la défense des droits culturels, on peut penser que cela aura rompu immédiatement l’alliance avec les auteurs. Et c’est aussi ce qui se produirait à présent s’ils cherchaient à le faire, car les auteurs verraient cette revendication comme une menace pour l’existence de leurs droits. L’exemption accordée par la SCELF n’a pas la même signification symbolique qu’une exception (même si paradoxalement, son effet pratique est plus puissant) : le droit de représentation des auteurs est bien toujours présent en arrière-plan sans être remis en cause dans son existence, mais en vertu d’une décision collective, il ne sera pas appliqué à un certain nombre de situations.
Il me semble donc que pour garantir l’effectivité du droit de lire en public, il valait mieux en passer par une exemption qu’une exception, et qu’il n’y a donc rien à regretter à l’issue de cette affaire. Mieux encore, ce mécanisme d’exemption au nom des droits culturels pourrait à mon sens être étendu à d’autres types d’usages en bibliothèque, qui n’ont toujours pas trouvé à ce jour de solutions satisfaisantes.
Transformer l’espace de la bibliothèque en une sphère libre d’usages non-marchands ?
Ce qui vient de se passer à propos des lectures publiques reflète en réalité des pathologies profondes affectant la condition juridique des bibliothèques. Un certain nombre d’usages – et non des moindres – s’exercent en bibliothèque sur la base de simples tolérances de fait, qui pourraient donc à tout moment être remises en cause par les ayants droit, tout comme la SCELF a tenté de le faire avec les lectures à haute voix. Nombreuses sont par exemple les bibliothèques qui proposent des jeux vidéo à leurs usagers, mais sans aucune base légale, comme l’admettait un rapport de l’Inspection Générale des Bibliothèques en 2015. Mettre à disposition des utilisateurs un outil comme un scanner est encore aujourd’hui quasiment impossible à faire sans violer la loi. Et je ne parle même pas du prêt de CD qui depuis des décennies s’exerce illégalement, faute d’être encadré par la loi sur le droit de prêt…
Le cadre législatif applicable aux bibliothèques reste encore en 2018 profondément lacunaire, ce qui en fait une « institution-pirate » malgré elle… Certes, l’absence de réaction des ayants droit montre qu’il existe en réalité un consensus social assez large pour que ces activités continuent à s’exercer en dépit de leur illégalité. Mais cela revient à courir un risque de remise en cause brutale et l’affaire de la SCELF a montré que ces faiblesses peuvent d’avérer très dangereuses si des ayants droit sont décidés à aller jusqu’au bout, car ils ont alors avec eux la puissance du droit. Pour remédier à cette situation, on pourrait imaginer bâtir un système complet d’exceptions au droit d’auteur couvrant l’ensemble des activités en bibliothèque. C’est notamment ce que propose depuis plusieurs années l’IFLA (International Federation of Libraries Associations) dans le cadre de négociations engagées autour d’un traité à l’OMPI. Mais ce processus est pour l’instant enlisé dans une impasse politique qui risque encore de durer de nombreuses années, en raison de l’opposition des ayants droit.
Dans ces conditions, pourquoi ne pas chercher à remédier à ces problèmes dans le cadre d’exemptions discutées avec l’ensemble des parties prenantes, sous l’égide des pouvoirs publics ? L’exemption accordée par la SCELF pourrait être vue comme la première étape d’un processus de négociations collectives ayant vocation à se dérouler tous les 5 ans pour évaluer la manière dont les droits culturels s’exercent en bibliothèque et quels sont les obstacles susceptibles d’être levés consuellement par voie d’exonérations actées par des accords.
Un premier chantier pourrait concerner la représentation des oeuvres en bibliothèque, au-delà des seules lectures publiques. Actuellement, la représentation des oeuvres dans les espaces physiques des bibliothèques est organisée sur la base de plusieurs mécanismes juridiques différents. Si rien n’a été mis en place pour les lectures publiques de textes, les jeux vidéo ou encore les expositions, il n’en est pas de même pour la musique avec des tarifs mis en place par la SACEM pour la sonorisation des espaces qui se payent à l’année dans le cadre d’un contrat signé avec la collectivité de tutelle de la bibliothèque. Pour les oeuvres audiovisuelles, un système de droit de consultation sur place des DVD s’est établi au fil du temps sur une base contractuelle dans le cadre d’offres proposées par des intermédiaires comme l’ADAV ou Colaco. Mais il reste assez imparfait, dans la mesure où il est loin de couvrir l’intégralité de l’offre audiovisuelle.
Ce régime bigarré pose de multiples questions par rapport à ce qui vient de se passer à propos des lectures publiques. Si une redevance sur les lectures publiques constitue une « absurdité symbolique », comme le dit la Ministre de la Culture Françoise Nyssen, en quoi serait-elle plus légitime pour l’écoute de musique, le visionnage d’œuvres audiovisuelles ou l’utilisation de jeux vidéo lorsqu’ils s’effectuent dans les emprises des bibliothèques ? Si l’on se place dans l’optique du respect des droits culturels, ne doit-on pas aller jusqu’au bout de la logique et considérer que l’espace de la bibliothèque devrait devenir une sphère d’usages libres et gratuits pour tous les types d’œuvres figurant dans ses collections ?
On pourrait imaginer l’ouverture de négociations collectives pour faire progressivement entrer ce projet dans les faits sur la base de plusieurs exemptions formalisées par des accords passés entre les acteurs concernés : auteurs, intermédiaires comme les éditeurs et les producteurs, bibliothécaires, représentants des collectivités locales et de l’Etat, mais aussi des représentants du public à travers des associations culturelles. Car c’est aussi une autre caractéristique fondamentale des droits culturels : ils doivent faire l’objet d’une discussion démocratique associant toutes les parties prenantes, de manière à leur permettre de jouer un rôle actif dans la mise en oeuvre de leurs droits.
Construire des solidarités actives entre bibliothèques et auteurs
On me dira certainement que cette idée est irréaliste et que dans les faits, elle porterait préjudice aux auteurs, qui touchent déjà une rémunération sous la forme des redevances perçues par la SACEM pour la sonorisation des espaces ou par des intermédiaires comme l’ADAV pour les oeuvres audiovisuelles. Une telle critique serait assez fondée dans l’absolu, mais je vais compléter ma proposition en précisant que je suis favorable à ce que les bibliothèques versent quelque chose aux auteurs, à condition que cela se fasse en accord avec la logique des droits culturels.
Actuellement, les rémunérations versées au titre des actes de représentation dans les bibliothèques se font sur la base de l’idée que ces usages constituent un préjudice infligé aux auteurs et à leurs ayants droit. Or je rejette cette idée qui ne correspond pas à la réalité : l’usage des œuvres en bibliothèque est l’une des manifestations du « droit de participer à la vie culturelle » reconnu par les textes fondamentaux sur les droits culturels, et à ce titre, on ne devrait pas interpréter ces pratiques comme un préjudice causé appelant réparation.
Néanmoins, les droits culturels sont indissociables des autres droits fondamentaux et ceux-ci comportent en leur sein l’impératif de la justice sociale. Or si je suis sensible à la question des usages collectifs de la culture, je suis également attaché à l’idée que la société doit offrir en son sein une juste place aux créateurs. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet impératif de justice sociale est très imparfaitement réalisé aujourd’hui. On sait que la condition des créateurs reste encore très précaire pour ceux qui veulent s’adonner complètement à cette activité et de très fortes inégalités existent entre les créateurs eux-mêmes. Seule une petite minorité arrive à vivre effectivement et dignement des revenus tirés de leurs pratiques, tandis que la grande majorité doit survivre dans des conditions souvent très difficiles.
Dès lors, je pense que les bibliothèques pourraient verser aux auteurs une « contribution de solidarité », à condition que celle-ci ne soit pas considérée comme la contrepartie d’un préjudice causé par leurs activités, mais comme un instrument de réalisation de la justice sociale et de concrétisation des droits culturels. De la sorte, des usages comme les lectures publiques resteraient bien « gratuits » et on pourrait même envisager de construire par voie d’exemptions progressives une sphère libre d’usages non-marchands pour tous les types d’œuvres en bibliothèque. Mais pour autant, les bibliothèques prendraient leur part dans la chaîne des solidarités nécessaires pour qu’une société fasse une place juste aux créateurs en son sein.
Chaque bibliothèque publique pourrait ainsi verser au titre de cette contribution une somme calculée sur la base du nombre d’usagers inscrits. Ces versements mutualisées pourraient ensuite servir à deux objectifs : verser une « rémunération socialisée » aux auteurs et renforcer leurs droits sociaux. Sur le premier point, un complément de rémunération pourrait ainsi être alloué aux auteurs individuels, qui viendrait s’ajouter à leurs droits d’auteur, en prenant comme clé de répartition les achat de supports effectués par les bibliothèques. Chaque année, la SOFIA publie ainsi un bilan des sommes qu’elle reverse aux auteurs au titre du droit de prêt et ce qu’elle montre, c’est que les achats des bibliothèques se répartissent sur un nombre de titres bien plus large que ceux achetés par les consommateurs sur le marché de la culture. C’est en cela que les bibliothèques sont des acteurs importants pour promouvoir la diversité culturelle à côté du marché, qui tend au contraire à concentrer l’essentiel des rémunérations sur un petit nombre d’oeuvres et d’auteurs (effet best sellers, hits, blockbusters, etc.). Voilà pourquoi il y aurait intérêt à ce qu’une partie de la contribution de solidarité des bibliothèques serve à financer un « revenu socialisé » pour les auteurs.
Une autre piste d’emploi de cette contribution de solidarité des bibliothèques pourrait consister à renforcer les droits sociaux des auteurs. On pourrait en la matière s’inspirer de ce qui existe déjà avec le droit de prêt des livres en bibliothèque, dont une partie de la rémunération sert depuis 2003 à financer la retraite des auteurs de l’écrit. J’ai déjà eu l’occasion de dire que ce mécanisme de solidarité devrait être approfondi en l’articulant au prêt de livres numériques en bibliothèque, mais on pourrait aussi imaginer renforcer ou financer de nouveaux droits sociaux pour les auteurs par le biais d’une contribution de solidarité. Cela pourrait notamment être un levier pour abaisser le seuil d’affiliation à l’Agessa (8703 euros de revenus artistiques par an) qui fait que seule une petite partie des artistes-auteurs ont accès à une couverture sociale (maladie, maternité, invalidité, prestations familiales, retraites). Cela pourrait aussi être l’occasion d’explorer des pistes plus innovantes, comme celle de mettre en place un régime d’intermittence pour les artistes-auteurs qui avait été proposée par certains partis lors de la campagne présidentielle.
Financer les solidarités ou subventionner le marché culturel ?
On me rétorquera sans doute que ces propositions sont irréalistes, car les finances publiques sont exsangues, tant au niveau local que national et les bibliothèques publiques ne supporteraient pas la charge supplémentaire que représenterait cette contribution de solidarité. Mais je demande à voir !
Car le gouvernement est bien en train de plancher pour mettre en place, dès septembre 2018, son fameux « Passe Culture » issu des promesses de campagne du candidat Macron, sous la forme d’une aide de 500 euros versés chaque année aux jeunes de 18 ans pour financer leurs dépenses culturelles. Le montant de cette opération serait, d’après ce que l’on peut lire dans la presse, de l’ordre de 450 millions d’euros par an, une somme considérable que le gouvernement a pourtant bien l’air décidé à rassembler malgré l’état des déficits publics.
Mais cette mesure du « Passe Culture » est à l’opposé de la vision des droits culturels, des solidarités actives et de la justice sociale que j’essaie de défendre dans ce billet. Car elle reviendra à effectuer chaque année des injections massives d’argent public directement dans le marché de la culture, qui continuera à répartir ces sommes selon la logique inégalitaire qui le caractérise, c’est-à-dire au bénéfice principal d’une toute petite minorité d’auteurs. Loin de contribuer à favoriser la diversité culturelle, ce dispositif ne peut que creuser encore les inégalités qui existent entre les artistes.
Dans l’intérêt même de l’immense majorité des créateurs, il vaudrait donc mieux que ces financements aillent à des mécanismes de solidarité qui vendraient contrebalancer les effets négatifs du marché de la culture plutôt que de les alimenter encore…
***
L’exemption accordée par la SCELF pour les lectures publiques n’est donc pas une fin en soi et elle pourrait même devenir le début de quelque chose de beaucoup plus profond, à condition que les différents acteurs se saisissent de l’opportunité politique unique que leur alliance de circonstance a fait naître. Ce serait une manière de sortir enfin de la guerre de tranchée stérile qui a si longtemps opposé auteurs et bibliothécaires, et que nous pouvons aujourd’hui dépasser en nous repositionnant ensemble sur le terrain de la réalisation des droits culturels.