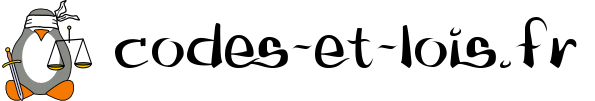La lettre et le texte : quand le droit se mêle de traduction
Le blog Dalloz - bley, 19/03/2012
 La traduction est aussi une affaire de querelles. Nombreuses sont les batailles qui ont émaillé le cours des siècles ; plus encore d’ailleurs que sur des mots ou des expressions, mais opposant de véritables conceptions esthétiques et linguistiques. Les affrontements entre traducteurs n’ont pas toujours eu grand chose à envier à ceux, pourtant plus habituels, entre littérateurs. Au XVIIe siècle finissant, la traduction de Tacite fournit un exemple de ces combats qui se sont parfois déroulés aux termes de round et de propos peu amènes. L’un des traducteurs de l’historien romain, Perrot d’Ablancourt, dont on disait de ses traductions qu’elles étaient de belles infidèles, fut vertement attaqué dans son travail par un collègue : Amelot de la Houssaye.
La traduction est aussi une affaire de querelles. Nombreuses sont les batailles qui ont émaillé le cours des siècles ; plus encore d’ailleurs que sur des mots ou des expressions, mais opposant de véritables conceptions esthétiques et linguistiques. Les affrontements entre traducteurs n’ont pas toujours eu grand chose à envier à ceux, pourtant plus habituels, entre littérateurs. Au XVIIe siècle finissant, la traduction de Tacite fournit un exemple de ces combats qui se sont parfois déroulés aux termes de round et de propos peu amènes. L’un des traducteurs de l’historien romain, Perrot d’Ablancourt, dont on disait de ses traductions qu’elles étaient de belles infidèles, fut vertement attaqué dans son travail par un collègue : Amelot de la Houssaye.
Dans l’une de ses préfaces, il ironisait en prétendant que Perrot aurait « pour partisans tous ceux qui n’ont jamais lu les originaux grecs et latins qu’il a traduits » (La morale, 1686). Ces mots très durs suscitèrent une réaction de la part du neveu : Frémont d’Ablancourt. En 1686, il publia à Amsterdam un libelle intitulé : Perrot d’Ablancourt vengé, ou Amelot de la Houssaye convaincu de ne pas parler français et d’expliquer mal le latin. Défendant son oncle, il mit Amelot au défi de traduire de nouveau, et correctement, l’historien, ce qu’il s’empressa de faire en 1690. Ainsi en va-t-il de la traduction : elle est source de dissensions et d’intenses discussions. Il ne peut en être autrement, tant elle procède d’une réelle réflexion intellectuelle et d’une grande sensibilité. Entre les premiers littéralistes obnubilés par le strict respect du mot sacré et les partisans d’une langue belle et épurée, entre les évolutions du langage affectant régulièrement des expressions devenues surannées et les mutations perpétuelles des idiomes contemporains qu’implique la transformation des moeurs, traduction ne peut rimer qu’avec interprétation. Voltaire lui même s’était fait l’écho de cette opposition quand il s’amusa à traduire quelques lignes de Shakespeare : « Malheur aux faiseurs de traductions littérales, qui en traduisant chaque parole, énervent le sens. C’est bien là qu’on peut dire que la lettre tue et que l’esprit vivifie » (Les lettres philosophiques, 18e)
La traduction de la petite pièce de l’auteur argentin Raphaël Spregelburd, né en 1970, a donné naissance à l’un de ses conflits. La particularité de cette affaire est que le droit s’en est mêlé. Ici, le juge devait trancher entre la lettre et l’esprit non pas à propos d’une disposition, comme d’accoutumée, mais, cette fois-ci, d’un texte littéraire. En l’espèce, la Estupidez appartenait à une série inspirée d’un tableau de Bosch supposé représenter les sept pêchés capitaux. Dans le cadre d’une représentation au théâtre national de Chaillot en avril 2008, Marcial di Fonzo Bo, metteur en scène et fondateur de la Compagnie des Lucioles, s’était rapproché de deux traductrices spécialisées dans la littérature sud-américaine et qui avait déjà commencé de traduire Spregelburd. Même si un premier projet avait déjà été déposé à la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD), la collaboration finit par échouer en raison de l’antagonisme des perceptions du texte source entre les traductrices et le metteur en scène. Le théâtre de l’argentin est situationniste, ce qui n’a pas manqué d’échapper à la cour d’appel de Paris amenée à connaître de l’affaire : « le théâtre de Spregelburd est un théâtre de situations, davantage scéniques que littéraires, qui confère une place essentielle au travail de plateau mené par le metteur en scène avec les acteurs, et où la poétique n’est pas axée sur la beauté du langage mais sur la beauté des situations ». Aussi, Marcial di Fonzo Bo s’est rapproché d’un autre traducteur, avec lequel il travailla de concert. Le résultat servit de texte pour la pièce présentée au théâtre national de Chaillot, laquelle obtint un beau succès.
Les premières traductrices ne furent pas satisfaites et assignèrent en contrefaçon sur le fondement de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle les traductions étant protégées par le droit d’auteur (P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. « Droit », 2010, n° 51, p. 70). Déboutées en première instance, elles interjetèrent appel.
Dans un arrêt du 25 janvier 2012, la cour d’appel de Paris ne les a pas suivies dans leur argumentation. Tout en reconnaissant que l’originalité et l’antériorité de la traduction des premières collaboratrices du metteur en scène ne pouvaient être contestées, les magistrats ont estimé qu’il n’y a pas eu de contrefaçon. Selon eux, la seconde traduction ne reproduit pas la première.
Dans un litige en contrefaçon, la démarche que doit entreprendre le juge n’est pas toujours aisée. Il convient de « rechercher et faire l’addition finale de tous les points de ressemblance “caractéristiques” entre les œuvres »(P.-Y. Gautier, op. cit., no 750, p. 801). Pour les traductions, la tâche est encore plus difficile dans la mesure où les deux éléments en comparaison proviennent d’un texte source identique. L’appréciation de la contrefaçon est donc loin d’être une affaire rapidement entendue, étant donné que, par essence, les traductions tendent vers une certaine ressemblance. Pour ces écrits d’un genre particulier, « la comparaison portera sur le choix des mots et expressions caractéristiques » (P.-Y. Gautier, op. cit., no 752, p. 804).
Comme exemple de cette délicate démarche, le raisonnement de la cour d’appel se révèle très intéressant. La cour tend à démontrer, dans un premier temps, qu’une réelle différence d’esprit opposait les deux « groupes » de traducteurs, dans l’approche du texte, c’est-à-dire de véritables « partis-pris opposés », selon l’expression des juges.
Dans un second temps, la décision prend soin de se livrer à une analyse poussée de l’œuvre de Spregelburd, considérant que son style, « d’une grande simplicité, parfois prosaïque, ne laisse pas toujours une grande latitude au traducteur soucieux de rester fidèle à la lettre du texte ». La cour considère qu’il existe de grandes différences entre les deux traductions, lesquelles aboutissent à des « impressions d’ensembles distinctes » : la première obéirait à un « style littéraire et académique », la seconde serait plus « orale et spontanée ». La différence procéderait, selon les juges, d’un écart de génération entre les traducteurs, et se manifesterait, dans la seconde traduction par les indices suivants : un vocabulaire peu conventionnel et trivial, un tutoiement systématique, et une susbstitution de références culturelles françaises à l’évocation de l’univers argentin. Pour le metteur en scène, l’idée était de privilégier la finalité scénique, ce que ne rendait pas suffisamment la première traduction.
Un texte source unique, certes, mais deux compréhensions et, donc, deux restitutions très différentes. C’est précisément tout l’attrait de l’immense travail du traducteur. La traduction n’est jamais figée, elle est en perpétuelle mouvement, notamment parce qu’elle est aussi l’expression de la sensibilité et de la perception de son auteur. Parce qu’elle favorise, en quelque sorte, le pluralisme, cette décision de la cour d’appel de Paris participe indéniablement de la protection du traducteur.
Thibault de Ravel d’Esclapon
Chargé d’enseignement
Université de Strasbourg – Faculté de droit
Centre du droit de l’entreprise