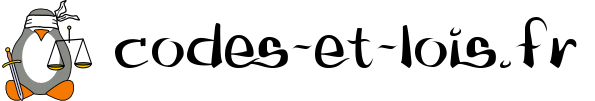L’ordonnance Belle et Bête et le journalisme juridique comme chaînon manquant
Le blog Dalloz - bley, 19/03/2013
 Deux choses en particulier, relevant de la sociologie du droit, ont frappé l’attention dans ce que l’on a vu ou entendu dans la presse ou à la télévision de l’affaire Belle et Bête : les certitudes affichées ici ou là de ce que les éditions Stock et/ou Le Nouvel Observateur ne « risquaient rien » ou pas grand-chose et la difficulté de l’AFP à saisir l’originalité de l’affaire et à solliciter les analyses juridiques contradictoires auxquelles se prêtent presque toujours les questions de droit.
Deux choses en particulier, relevant de la sociologie du droit, ont frappé l’attention dans ce que l’on a vu ou entendu dans la presse ou à la télévision de l’affaire Belle et Bête : les certitudes affichées ici ou là de ce que les éditions Stock et/ou Le Nouvel Observateur ne « risquaient rien » ou pas grand-chose et la difficulté de l’AFP à saisir l’originalité de l’affaire et à solliciter les analyses juridiques contradictoires auxquelles se prêtent presque toujours les questions de droit.
Pour tout dire, c’est un peu navré que l’on a vu autrefois le type de certitudes qui vient d’être rapporté retentir sur la défense du Procès de Jean-Marie Le Pen de Mathieu Lindon (POL). Ainsi, lorsque, dans les colloques, les revues juridiques et les journaux, il était répétitivement dit que la France serait « sûrement condamnée » par la Cour européenne des droits de l’homme si la Cour de cassation n’invalidait pas la condamnation de l’auteur, de son éditeur et du journal Libération, nous étions quasiment seul à soutenir que rien n’était moins sûr et qu’il fallait donc proposer à la Cour européenne une argumentation autrement plus élaborée que celle proposée aux juridictions internes et moins teintée de considérations morales sur le caractère de « bonne cause » de l’ouvrage litigieux. On sait comment ça s’est terminé (« à la surprise générale ») devant la Cour dans Lindon, Otchakovsky-Laurens and July c. France (22 oct. 2007).
Dans le cas qui nous intéresse, l’AFP a donc publié une dépêche sur la « sévérité » supposée de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2013, une dépêche discutable en presque tous les points et que l’on soupçonne d’avoir « excité » la tentation des dirigeants du Nouvel Observateur de faire appel lorsque l’avocat traditionnel du magazine semblait avoir pris la mesure des choses et de la difficulté d’aller en appel sans les éditions Stock et l’auteur (V. art. du blog du Monde). La lecture de l’article consacré par Pascale Robert-Diard à la décision du Nouvel Observateur de ne pas se pourvoir en appel contre l’ordonnance du 26 février 2013 est, à cet égard, éclairante sur les représentations de certains acteurs de la presse. On apprend ainsi que, dans la perspective de l’appel, le propriétaire du Nouvel Observateur avait envisagé de dessaisir du dossier « l’avocat habituel » du magazine au profit d’un avocat qui aurait eu pour mission « de se montrer très offensif ». C’était injuste pour un avocat dont les écritures devant le juge des référés étaient des meilleures possibles compte tenu des circonstances de l’espèce. C’était surtout un peu naïf : les dirigeants du Nouvel Observateur ont failli céder à une vision magique de « l’avocat de presse », une vision très courante chez les professionnels de la presse.
Dans ces conditions, il fallait une certaine naïveté pour concevoir que Le Nouvel Observateur pût gagner en appel en disant simplement qu’il n’a fait que « rendre compte » du roman ou que les dommages-intérêts qui lui ont été infligés ne sont pas ceux qui se pratiquent « habituellement » devant les « chambres de presse » : si les avocats de M. Strauss-Kahn avaient cédé à cette « routine mentale », ils n’auraient sans doute pas demandé une réparation globale de 100 000 € et ils n’auraient pas choisi la stratégie consistant à demander à titre principal l’insertion d’un encart et la publication d’un communiqué judiciaire et seulement à titre subsidiaire l’interdiction de toute diffusion de l’ouvrage. Une importante nuance qui n’a pas empêché beaucoup d’organes de presse et de radiotélévision d’écrire ou de dire que M. Strauss-Kahn « demande l’interdiction de l’ouvrage ». Et, après coup, de ne pas s’aviser de ce que la double question qui compte, au regard notamment de la Convention européenne des droits de l’homme, est de savoir si la réparation est en rapport raisonnable avec le préjudice et si elle n’est pas de nature à avoir un effet réfrigérant sur la liberté d’expression.
Ce sont donc des travaux de sociologie judiciaire ou de science politique du droit (il en existe à l’étranger, spécialement dans les pays où les Socio-Legal Studies sont développées) qu’il faudrait consacrer par exemple au traitement par les médias des « affaires de presse » (y a-t-il des biais induits par le fait qu’ils sont en quelque sorte « juges et parties » ?). Ce sont d’autres études de sociologie judiciaire qui sont susceptibles, par exemple, de dire si, dans les affaires dites « de presse », les audiences ont l’importance déterminante que leur prêtent les médias. En effet, ces contentieux ont ceci de particulier que les juges sont pris dans un système de contraintes argumentatives tel (celui découlant de la nécessité de « concilier », en fonction des « considérations de l’espèce », des droits et libertés en conflit ou de dénouer un conflit entre une liberté fondamentale et un motif « prépondérant d’intérêt public ») qu’ils ne peuvent pas ne pas privilégier les écritures des parties. Celles-là mêmes qui, seules, compteront en cassation ou devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Il manque sans doute aussi des travaux sur les discours extra-judiciaires relatifs à la liberté d’expression de ceux des avocats spécialisés dans le droit des médias qui sont les plus sollicités par les médias : ces discours, qui sont des discours d’acteurs d’un système, sont-ils nécessairement éclairants des décisions judiciaires, sachant que ces décisions ne sont pas commentées par les juges qui les ont rendues et qu’il n’existe pas vraiment en France de journalistes juridiques à l’anglo-saxonne pour servir de passerelles entre le grand public et les juges (on reviendra sur ce point) ? Ces discours ne sont-ils pas inhibés par la nécessité de ne pas passer pour un « adversaire » de la liberté de la presse ? Il n’est pas indifférent, en effet, que les avocats de M. Strauss-Kahn aient dû répéter à l’envi qu’ils étaient d’autant moins des « censeurs » qu’ils avaient fait leurs preuves dans le passé dans la défense de la presse. Ce qui était une façon de suggérer que, dans le système de représentation de leurs interlocuteurs journalistes, à moins de « traîtrise », les « avocats de presse » sont ou devraient nécessairement être du côté de la presse. Ce système de représentation − on raisonne ici à la seule échelle de la France tant il est vrai que les cultures journalistiques, les représentations professionnelles des journalistes sont très variables d’une société à une autre, ces différences ayant une résonance sur les traitements juridiques du journalisme dans certains ordres juridiques −, qui avait une cohérence du temps de la majesté et de la souveraineté de la « grande presse » et du temps où il fallait endiguer les prétentions de contrôle des autorités publiques, est devenu pratiquement inexigible à l’heure de l’explosion médiatique, de l’explosion de la presse « d’en bas » (l’expression n’a ici aucune connotation négative), de la demande par les personnes physiques ou morales non étatiques de droits concurrents et effectifs mais concurrents (droit à l’image, droit à la vie privée) de la liberté de la presse.
Arrêtons-nous enfin sur la question du journalisme juridique en partant des États-Unis, ce qui, somme toute, est logique, compte tenu du statut mythologique du « journalisme américain » (expression discutablement holiste) depuis l’affaire du Watergate. Dans le contexte américain, les journalistes juridiques travaillent, pour certains, comme rédacteurs de publications juridiques tournées vers les professionnels (il en existe en France) et, pour d’autres, comme rédacteurs pour la presse générale (il n’y a pas de grande agence de presse, de grand journal, de grande chaîne de télévision qui n’aient pas de journaliste accrédité auprès de la Cour suprême, auprès du Département de la justice, etc. ; il n’y a pas de grand journal régional qui n’ait pas de journaliste accrédité à la Cour suprême de l’État…). C’est cette seconde catégorie de journalistes juridiques qui n’existe pas vraiment en France alors que c’est elle qui, par exemple, introduit dans le débat public accueilli par les journaux, les radios et les télévisions, du matériau intellectuel tiré de sa lecture et de sa connaissance, d’une part, des essais juridiques (catégorie éditoriale surplombante et distinctive du juriste universitaire ou praticien aux États-Unis (V. art. du Blog Dalloz), où les manuels sont infiniment plus rares qu’en France), d’autre part, des articles de revues juridiques savantes ou non.
De fait, ce sont ces journalistes juridiques des grands journaux et des grandes chaînes de télévision qui convient dans les colonnes de leurs journaux ou sur leurs plateaux les opinions juridiques des universitaires ou des praticiens. Au demeurant, il nous semble que, dans une société à forte culture du procès et des « opinions séparées » comme les états-Unis, ces journalistes juridiques conçoivent « naturellement » qu’il y ait presque toujours des analyses contradictoires, lorsqu’en France, le fait de dire qu’il existe plusieurs « possibilités » disponibles pour le juge (ou le législateur) vous vaut d’être analysé par le journaliste comme voulant « faire un cours d’amphi ». Et puis, dans une société plus démocratique (ou moins « aristocratique ») comme les états-Unis, les journalistes sont moins attirés par le « statut » ou la position institutionnelle de celui qui parle que par le point de vue qu’il apporte : « Vous auriez en France quelqu’un comme Richard Posner », nous disait un jour ironiquement un ami américain francophile, « il serait seul à être interviewé à la radio et à la télévision sur tout ce qui touche au droit et vous seriez dans des débats sans fin sur la date de sa nomination au Conseil constitutionnel ».
Est-il possible d’importer, en France, le type de journalisme juridique dont il est ici question ? Rien n’est moins sûr, tant ce journalisme est plutôt caractéristique de sociétés où le droit tient lieu de religion civile. Ce dont on est sûr, c’est qu’en toute hypothèse, la « solution » ne passe pas par la création de diplômes de journalisme juridique dans les facultés de droit alors que les offres de recrutement des journalistes ne sont pas prolifiques et que le marché des journalistes professionnels est « tenu » en France par les écoles de journalisme.
Pascal Mbongo
Professeur des facultés de droit à l’Université de Poitiers,
Président de l’Association française de droit des médias et de la culture,
Directeur de l’Université d’été en droit américain